On ne comprend évidemment rien à ce qui fait époque aujourd’hui – l’empire de fake news, les faits alternatifs, la prolifération des révisionnismes historiques les plus décomplexés (parmi les élites politiques non moins que parmi les addicts aux réseaux sociaux) si l’on persiste à considérer comme parole d’Évangile la séparation rigoureuse opérée par Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme entre ce qu’elle désigne comme la propagande totalitaire (inséparable de la singularité des mouvements et des régimes totalitaires) et d’autres formes d’adresses aux masses ou de mobilisation idéologiques de celles-ci, telles qu’elles auraient cours dans les sociétés non-totalitaires – c’est-à-dire, dans l’optique rigoureusement européo- ou occidentalo-centrique d’Arendt, les démocraties libérales, pour l’essentiel.
C’est sous nos latitudes (celles des démocraties libérales du Nord global) en premier lieu que le présent est désormais placé sous le signe de l’affaiblissement de nos capacités à opérer le partage entre le réel et le fictif, les faits avérés et les récits imaginaires, les mensonges, les falsifications et les récits fiables ; que le tangible tend à devenir nébuleux, que les réalités bis imposent leurs conditions, boostées par l’innovation technologique hors contrôle.
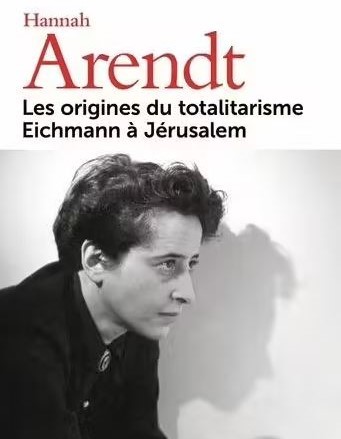
- A l’évidence, cette nouvelle et massive évanescence du réel comporte des enjeux qui vont bien au-delà de ce qui se subsume sous le vocable de propagande. À l’évidence, l’analyse arendtienne qui définit la propagande totalitaire comme le maximum, le plus perfectionné des dispositifs destinés à éloigner les masses de la réalité nous conduit dans une impasse. Moins que jamais, pour nous, le cloison étanche qu’érige Arendt entre une propagande totalitaire essentialisée, définie comme un objet compact, unique, sans précédent dans sa monstrueuse perfection même, et ce qui s’en distinguerait à l’évidence, voire s’y opposerait - moins que jamais ce divide rigoureux et supposément irrévocable ne fait sens. La dissolution des faits avérés et la conquête du monde par les narratives de circonstance inspirés par le pur intérêt et entièrement indifférents aux enjeux de la véracité voire de la vraisemblance, tout ceci constitue un enjeu global dans un contexte où est devenue inopérante la partition opérée par Arendt entre le totalitaire et ce qui est supposé s’en séparer et s’y opposer. Ce serait plutôt, entre autres, à partir de l’omniprésence (l’ubiquité) d’Internet et de l’intelligence artificielle que ces questions seraient à repenser.
L’essai d’Arendt (celui qui a fait sa célébrité et continue à être considéré comme son maître ouvrage) est traversé par une faille majeure. Y revenir peut nous aider à prendre prise sur les enjeux de cette sorte de guerre des mondes qui oppose aujourd’hui le souci du réel à la prolifération des narratives destinés (ou voués, sans que cela relève d’intentions particulières) à rendre le réel flottant, inconsistant, grumeleux, insaisissable. Ce n’est pas que l’auteur des Origines se contredirait au fil des trois volumes qui constituent cet ouvrage (l’antisémitisme, l’impérialisme, le totalitarisme), c’est plutôt que l’essai est miné par une incohérence qui rend l’édifice totalement branlant. En bref, Les Origines du totalitarisme se présente comme une généalogie de la modernité (européenne, occidentale, Arendt n’en connaît ou reconnaît pas d’autre) placée sous le signe de la montée des masses, signe elle-même de l’effondrement de ce qui pouvait s’apparenter à un ordre, fondé sur le fragile équilibre d’un ensemble dont l’unité de compte était l’État-nation.
Avec cet essai, il s’agit bien de remonter aux sources de la catastrophe historique et politique que constituent les phénomènes totalitaires. L’approche de ceux-ci est régressive, il s’agit de reconstituer la dynamique et la combinaison des facteurs, l’enchaînement des circonstances qui conduisent à la formation des mouvements puis à l’établissement des régimes totalitaires. Arendt évoque les origines (au pluriel), c’est-à-dire les éléments dont la combinaison dynamique nourrit la provenance des phénomènes totalitaires – pour l’essentiel, selon son approche, l’antisémitisme et l’expansion de l’impérialisme européen.
On notera ici au passage une première tension entre le fait qu’à l’évidence le point de mire de cette généalogie est le fascisme hitlérien, alors même que l’opération décisive, dans la promotion du concept de totalitarisme est le rapprochement entre le régime nazi et le régime stalinien.
En tout cas, cependant, l’analyse arendtienne place l’accent sur le fait que les phénomènes totalitaires prennent racine dans les traits essentiels de la modernité européenne en crise, à partir de la fin du XIXème siècle. Le totalitaire trouve ses prémisses et son sol dans l’apparition de la société de masse et la crise du « système » des États-nations, mais sans en découler mécaniquement – les régimes totalitaires sont demeurés, dans le contexte européen ou occidental, l’exception plutôt que la règle. Ce sont ici des processus dynamiques qui sont en jeu : la désintégration de l’ordre européen, lui-même établi, au XIXème siècle, sur les ruines des royaumes, empires et régimes soumis au principe dynastique.
Toute cette partie de l’analyse arendtienne est centrée sur ce que l’on pourrait appeler le procès au fil duquel l’apparition des mouvements totalitaires se nourrit de l’irruption de la masse sur la scène historique et dans la vie sociale, en Europe, à partir de la fin du XIXème siècle.
L’essentiel de l’essai, dans sa dimension analytique, est placé sous ce signe, celui des dynamiques, des processus, des combinaisons de facteurs. Mais lorsque les mouvements, les régimes et les sociétés totalitaires sont abordés comme cristallisation ou concrétion de ces processus, l’analyse bascule du côté du statique : il s’agit bien de promouvoir le totalitaire comme une catégorie compacte et molaire, dans une configuration où s’impose la perception dualiste, voire manichéenne d’un monde dans lequel se contrastent et se confrontent deux « mondes » engagés dans une bataille à mort – le totalitaire, nouveau Behémoth, avec ses traits monstrueux (il incarne la plus vitale des menaces pour la civilisation) et ce qui y résiste en perpétuant bon gré mal gré les traits de la civilisation occidentale – les démocraties libérales.
Dès lors que l’analyse se tourne vers les cristallisations totalitaires – les mouvements totalitaires, les sociétés et les régimes totalitaires, on entre dans le monde des essences et l’essai change de tonalité pour autant que ce qui y est désormais l’enjeu premier de l’analyse, c’est, du point de vue même de l’auteure comme de ses lecteurs, un autre défini comme absolu et absolument adverse – le totalitaire comme non seulement ennemi de la démocratie libérale, mais danger mortel pour la civilisation humaine – une parfaite dystopie. Ici se produit un retournement manifeste, ou une rupture dans l’analyse, pour autant que celle-ci passe du registre de la présentation des processus dans laquelle le « nous » formé par l’auteure et ses lecteurs.trices se trouve inclus.es (nous qui sommes enveloppés dans la genèse de la société de masse) cède la place à l’examen clinique de cette monstrueuse excroissance qu’est devenu le totalitaire sur le corps des sociétés occidentales, une tumeur mise en examen comme figure d’une altérité terrifiante – le totalitarisme en tant que défini en premier lieu par sa différence insurmontable et substantielle d’avec nous.
L’analyse aredtienne des phénomènes totalitaires passe par ce geste tranché consistant à enfermer le totalitaire dans sa différence radicale d’avec un « nous » supposé commun à l’auteure et au lecteur.trice, en d’autres termes un geste d’othering tranché et irrévocable. Le discontinu vient ici repousser à l’arrière-plan l’ensemble des continuités présentées dans les deux premières parties de l’essai.
Deux directions différentes se dessinent ainsi dans Les origines du totalitarisme, là où l’unité de l’essai semble se défaire pour donner lieu à deux livres différents : l’un, qui se déploie tout au long des deux premiers volumes, sur un mode généalogique, dans la dimension de la philosophie politique et qui consiste en une étude des « origines » d’une modernité placée sous le signe de l’avènement de l’ère des masses, dans l’espace européen, en Occident. L’autre qui est un livre de combat, enveloppé dans les plis d’un affrontement , dans un contexte dominé par la Guerre froide : celui qui oppose la démocratie libérale à son meilleur ennemi paré de la dignité du concept – le totalitaire. Un livre dont le milieu serait donc l’idéologie, plutôt que la pensée critique, dans ses effets pratiques et son « utilité » - Les origines du totalitarisme est devenu au fil des décennies, en Occident et dans les démocraties libérales, la référence des références en matière d’assignation de l’autre à sa place de menace vitale pour « nous » - le signifiant « totalitaire » étant ce qui permet d’assurer la continuité entre plusieurs figures de l’ennemi absolu dans un contexte renouvelé de « guerre des mondes » - du monde de Staline à celui de Xi, de la première à la seconde des Guerre froides.
Dans Les origines du totalitarisme, le glissement qui s’opère de la dimension analytique à la posture idéologique est subreptice. Il prend la tournure du passage d’une perspective dans laquelle l’objet central de l’étude est l’émergence de l’âge des masses, donc d’un plan large, à l’échelle de la modernité européenne ou occidentale, à une autre, dans laquelle est opéré un cadrage en gros plan fixe sur un débouché particulier de ce processus général – la cristallisation de régimes totalitaires. Ce qui, dans ce décrochage, disparaît, c’est la perspective auto-analytique (que nous est-il arrivé avec l’avènement de l’ère des masses, à nous, Européens modernes ?), au profit de la promotion d’un méta-concept de l’ennemi ou de la menace vitale - le totalitaire prenant la forme de concrétions de puissance extrêmes - l’Allemagne nazie lancée à la conquête de l’Europe entière, l’URSS comme superpuissance nucléaire en devenir, au fort de la Guerre froide – soit un « eux » aussi éloigné de « nous » et singularisé dans sa différence radicale et menaçante qu’il est possible. Comme chez Orwell, l’ombre de l’apocalypse plane sur l’analyse du totalitaire proposée par Arendt – le totalitarisme non pas comme adversaire ou ennemi ordinaire, mais comme menace pour la civilisation (tout court – pas seulement occidentale).
On remarquera que la production du totalitaire comme méta-concept (une opération proprement philosophique – Arendt parle du totalitarisme, en philosophe, d’une manière toute différente de la façon dont un historien parlerait des totalitarismes dans leurs contextes historiques respectifs ; l’opération arendtienne suppose une synthèse. Or, celle-ci, précisément, est à haut risque, analytiquement parlant, puisqu’elle est fondée sur davantage que le rapprochement, l’assimilation, entre deux régimes et deux sociétés, deux segments historiques que bien des choses différencient ou opposent – l’Allemagne nazie et l’URSS stalinienne – la concaténation de toute cette diversité. La production du concept de totalitarisme passe ici par un forçage, celui qui consiste à aplanir les différences, notoires, qui séparent ces deux objets pour les subsumer sous un seul et même concept, molaire et compact. On pourrait dire qu’est à l’œuvre ici un comparativisme expéditif, voire performatif – l’objet Allemagne nazie et l’objet Russie soviétique, l’objet « monde hitlérien » et l’objet « monde stalinien » relèvent de la même catégorie – je le dis, et qu’il en soit désormais ainsi.
Ce qui frappe, c’est que cette opération en forme de comparaison forcée au fil de laquelle l’argumentation ne parvient jamais à réduire entièrement la part du décisionnel ou du performatif est, en vérité la condition expresse d’une autre dont le principe est l’exclusion de toute espèce de perspective comparatiste – celle qui consiste à poser le totalitaire comme l’antagonique pur et simple de ce « nous » dont on ne voit pas très bien ce qu’il pourrait être, si ce n’est la démocratie libérale. C’est en ce sens même que ce qui avait commencé comme un essai (radicalement) critique sur la modernité occidentale se transforme au fil de son développement en pamphlet (de bonne tenue) de guerre froide ou de post-guerre froide – au temps de sa publication, la puissance nazie n’est plus qu’un souvenir (traumatique, certes), mais un souvenir, alors que l’URSS est une superpuissance équipée de l’arme atomique (depuis 1949).
L’analyse arendtienne consistant à combiner l’incomparable (du totalitaire à ce qui s’y oppose) avec le comparable à tous égards (les différents régimes totalitaires, l’Allemagne nazie et la Russie soviétique stalinienne), c’est-à-dire à mettre en avant sur un plan l’absolu (de l’incomparabilité) et sur l’autre le relatif absolument requis - cette démarche est frappée du sceau de l’incohérence. Cette inconséquence saute aux yeux lorsque Arendt aborde le motif (crucial à ses yeux) de la propagande totalitaire – le chapitre 11 de l’ouvrage. Elle y définit la propagande totalitaire par un certain nombre de traits saillants – mais en faisant de bout en bout l’économie de la démonstration (selon des règles qui sont celles de l’analyse théorique et pratique) que l’ensemble de ces traits ne s’identifient pas à des titres divers dans d’autres formes de propagande que la totalitaire ; ne sont pas identifiables et analysables dans leur relativité à ces formes, notamment celles qui prévalent dans le gouvernement et la mobilisation des masses sous les latitudes de la démocratie de marché, dans le monde des industries culturelles, de la publicité, de la politique spectacle…
L’analyse de la propagande totalitaire est enfermée dans la singularité absolue de celle-ci – un postulat ou bien, précisément, quod est (fuerit) demonstandum. C’est bien là la raison pour laquelle on peut dire à bon escient que la démarche arendtienne, sous son apparence démonstrative, accorde toute sa place au décisionnel et au performatif.
Cela est inévitable, du fait même que le socle, le point de départ de son argumentation est le fait massif de la société de masse, avec tous les traits caractéristiques de celle-ci : les individus composant la masse voient, dans les circonstances de la modernité la plus avancée, leurs liens à leur monde propre se défaire, ils perdent leurs repères, leur rapport à la réalité se trouve profondément affecté au fur et à mesure qu’ils sont exposés à ce processus d’atomisation. Ils sont en quête de moyens d’échapper à cette désorientation sans cesse croissante, au déracinement qui en constitue l’arrière-plan. C’est ici que la propagande totalitaire va leur offrir une issue (illusoire, imaginaire) hors de cette condition désemparée, en substituant des fictions utiles et rassurantes à une réalité sur laquelle les masses ont perdu prise.
On voir donc bien que, dans la perspective arendtienne même, le lien (et donc l’élément de relativité et de continuité) entre le totalitaire et ce qui le précède et en constitue le socle, l’antécédent, le terreau, ce lien est indéfectible. C’est donc par une sorte de coup de force (de décret) analytique que la propagande totalitaire va se trouver descellée, dissociée de tout ce qui en constitue la prémisse ; et qu’elle va pouvoir, dans le chapitre 11 du livre être décrite comme une sphère totalement séparée de toute autre forme de production de la mobilisation et de l’abrutissement des masses, en d’autres lieux, dans d’autres espaces ou séquences. Un unicum, une singularité absolue placée sous le signe de l’inquiétante étrangeté ou plutôt, sans ambages, du monstrueux et du sans précédent.
Or, le propre des deux premières parties du livre est, au contraire, de mettre en lumière tout ce qui a, ici, statut de précédance. La volte-face est visible à l’œil nu, là où ce chapitre sur la propagande totalitaire et tout ce qui l’entoure est placé sous l’égide de la singularité sans précédent. Par automatisme, « la démocratie », signifiant opportunément vide ici, c’est-à-dire disponible pour tous les usages, va devenir ce qui s’oppose à tout ce qui se subsume sous le syntagme « propagande totalitaire », « la démocratie », avec tous ses attributs supposés, l’existence d’une opinion placée sous le signe du pluralisme, associée à la liberté d’opinion et d’expression, etc.
Mais le retournement qui conduit de la démarche où l’accent est placé sur le processus à la perspective où s’impose le plan fixe (freeze frame) s’effectue au prix de l’apparition d’un angle mort : là où rien ne vient prouver, démontrer, la singularité absolue de la propagande totalitaire. La preuve étant que ceux qui, à la même époque, au fil du même parcours biographique et intellectuel qu’Arendt, prennent les choses par l’autre bout - les formes de mobilisation et d’abrutissement de la masse dans les démocraties libérales – Adorno, Horkheimer, Marcuse, Kracauer… développent une phénoménologie de l’ère des masses (et en tirent des conclusions théoriques et politiques) qui, à tous égards, se distingue de celle d’Arendt.
Ce qu’Arendt ne démontre jamais et considère comme acquis, c’est la discontinuité radicale supposée entre propagande totalitaire et formes de mobilisation, de manipulation ou d’enfumage des masses dans les sociétés libérales. C’est que le totalitaire doit être produit comme une méta-catégorie destinée à assigner à sa place d’ennemi absolu de la civilisation ce que les régimes libéraux désignent comme leur ennemi et leur antagonique absolu. Le geste qui porte à la production et la promotion de cette catégorie porte au-delà de l’othering dans son sens courant. Est ici en jeu non pas simplement la fabrication d’un autre, mais d’un ennemi radical désigné comme ennemi de la civilisation, un geste qui a pour effet de simplifier énormément la description du monde : celle-ci va avoir pour matrice le partage entre « eux » et « nous » et c’est en ce sens sur une pente toute naturelle que la perspective arendtienne trouve son débouché ultime dans la version politique reaganienne du conflit entre l’empire du Mal et, symétriquement, l’empire du Bien.
Tout le reste, et qui complique le tableau dans le contexte des luttes de décolonisation, de l’expansion de l’impérialisme états-unien à l’échelle de la planète, de la contre-révolution globale cornaquée par les Etats-Unis en Amérique latine, en Asie, en Afrique… tend à disparaître du tableau. L’accent porté sur le caractère sans précédent des phénomènes totalitaires, leur homogénéité en dépit des différences évidentes entre les espaces dans lesquels ceux-ci se sont développés, la propriété de la propagande totalitaire d’éloigner radicalement les masses de la réalité, tout ceci a pour effet d’enfermer l’analyse du présent dans des catégories monolithiques, fixistes et essentialistes qui, le vernis philosophique mis à part, sont celles de la Guerre froide.
Le projet analytique et critique d’Arendt apparaît toujours plus distinctement enveloppé, au fur et à mesure que l’on avance dans la lecture du livre, dans les plis de l’idéologie, c’est-à-dire de la guerre des mondes. Les catégories molaires, comme l’est exemplairement celle de totalitarisme, servent en premier lieu à faire bon marché des complexités et, en supportant la simplification à outrance de la description du présent, elles font le lit du retour en force de l’idéologie. Celle-ci en effet prospère constamment sur les simplifications, les tableaux sommaires et contrastés, la réduction de la description du monde à des slogans et des énoncés inlassablement répétés – d’où son étroite affinité avec la propagande. C’est ici que la boucle se boucle, que la faille qui traverse Les origines du totalitarisme devient béante : voici un livre de philosophie politique dont les faiblesses et les inconséquences ont ouvert les portes à ses emplois idéologiques ultérieurs, à son idéologisation majeure. Un livre qui met en exergue la propagande portée à son plus haut degré d’incandescence comme le trait singulier du totalitaire et dont, depuis les dernières décennies du siècle dernier, les propagandes de guerre froide néo-impérialistes et hégémonistes de la démocratie de marché ont fait leurs choix gras – une enseigne scintillante de la nouvelle Guerre froide.
À suivre…